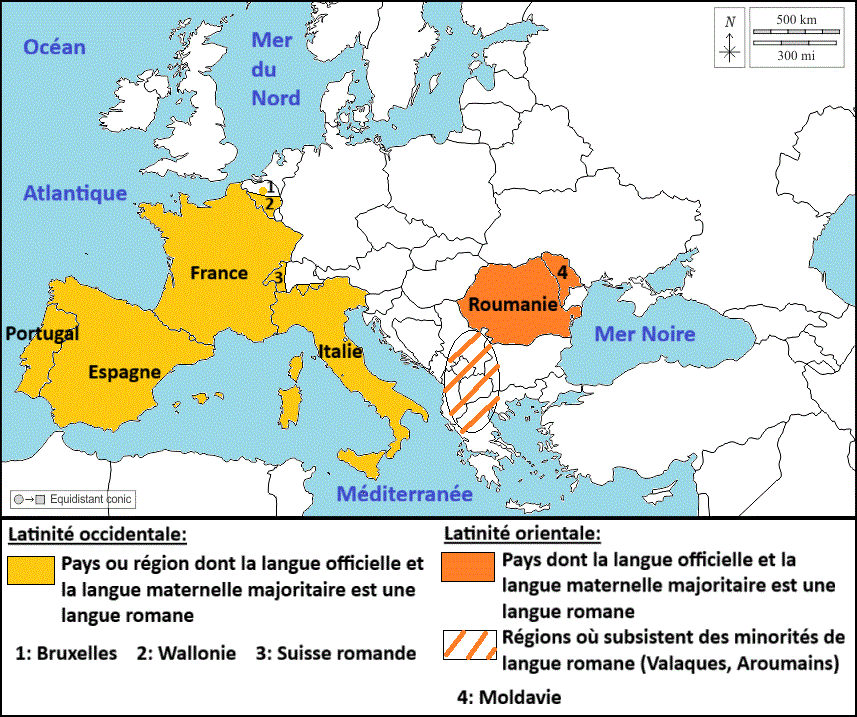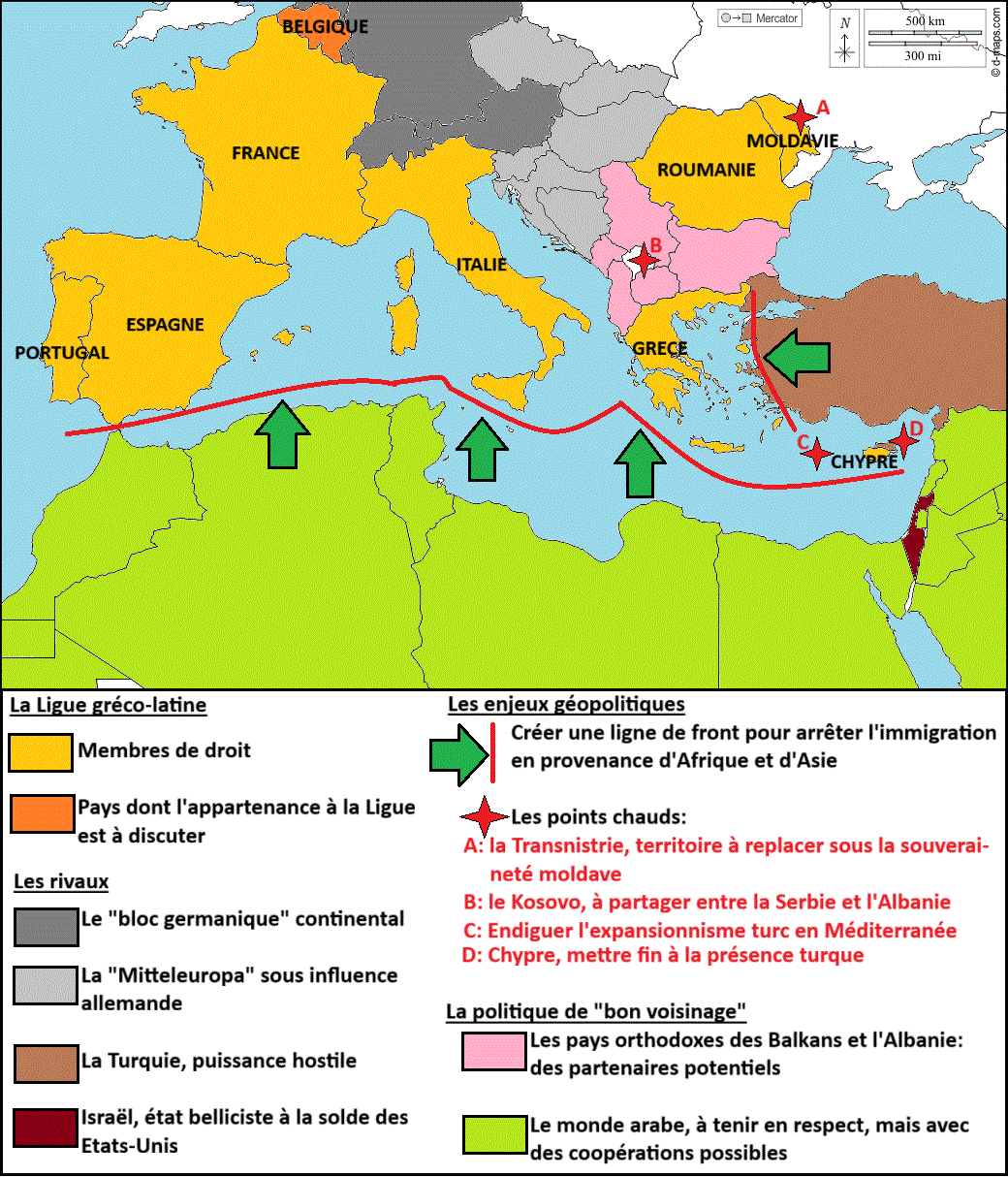Le rôle historique de la Latinité
Certains lecteurs, peut-être, me feront grief de ne pas commenter le grand chamboulement du monde, mais je dois avouer que dans ce jeu complexe entre Américains, Russes, Chinois et même Indiens, il est bien difficile d'y voir clair. Quel est l'état exact du rapport de force? Quelles sont les arrière-pensées des uns et des autres? Qu'est-ce qui, dans le flot continu de menaces, de rodomontades, d'avertissements qu'on entend en permanence, relève de la déclaration d'intention ou de l'engagement réel? Seul un diplomate professionnel, rompu aux arcanes de la politique internationale, pourrait le dire. Or je ne suis pas diplomate et je n'ai pas la chance d'en connaître. Ce que je vois, c'est que le conflit en Ukraine s'éternise et qu'il risque fort de mal se terminer pour les Ukrainiens. Ce que je constate, c'est que la Russie joue un jeu dangereux avec ses provocations en direction de la Pologne et de la Roumanie. Les Russes ne devraient pas sous-estimer l'envie d'en découdre qui existe au sein de certains pays de l'OTAN. Ils s'imaginent sans doute que les Américains "tiennent" leurs vassaux, pardon, leurs alliés, mais il faut faire attention: je ne doute pas un instant que Washington est prêt à laisser tomber Kiev, mais qu'arriverait-il si Varsovie ou Vilnius, s'estimant menacés, déclenchait un conflit? Les Américains pourraient-ils, sans perdre toute crédibilité, laisser la Russie écraser la Pologne et les pays baltes? Je n'en suis pas convaincu. Certes, Donald Trump estime que la guerre russo-ukrainienne a assez duré, mais tout montre que les Etats-Unis ne veulent surtout pas d'une Russie trop puissante. C'est pourquoi, au-delà des jérémiades qu'on entend du type "Trump pactise avec Poutine et nous abandonne", je ne crois pas un instant que les Yankees seraient disposés à laisser la Fédération de Russie reprendre le terrain perdu en Europe centrale. En ce qui concerne le Proche-Orient, j'ai dit déjà ce que j'avais à en dire: Israël est en train de commettre un crime qui aura des répercussions incalculables. C'est une catastrophe pour les Palestiniens d'abord, martyrisés, chassés de chez eux (à Gaza comme en Cisjordanie), affamés. Mais c'est aussi une catastrophe pour l'Etat hébreu et pour tous les juifs de par le monde. Israël se rendra bientôt compte que l'étiquette d'"Etat criminel" n'est pas simple à porter sur le long terme. Malheureusement tous les juifs seront tenus pour complices de cette ignominie. Et l'Occident, qui bombarda Belgrade ou Tripoli pour moins que ça, sera accusé à juste titre de faire du "deux poids, deux mesures".
Et la France dans tout ça? Répétons-le, elle est inexistante, inaudible, quantité négligeable. Les présidents atlantistes qui ont succédé à Chirac ont en vingt ans réussi à faire ce que de Gaulle s'était échiné à éviter: faire de notre pays un "Etat occidental" comme les autres, c'est-à-dire un caniche des Etats-Unis. On ne refera pas l'histoire bien sûr, mais rétrospectivement, il eût peut-être mieux valu laisser les mercenaires hessois et hanovriens de Georges III massacrer les Insurgents. La France aujourd'hui traîne son appartenance à l'Occident comme un bagnard traîne son boulet. Parce que l'Occident, aujourd'hui en ce début de XXI° siècle, est dominé par la culture et la mentalité germaniques, anglo-saxonne pour une bonne part, allemande dans une moindre mesure. L'hégémonie anglo-saxonne, tout le monde peut l'observer: nos villes sont envahies d'enseignes et de publicités en anglais, nos cinémas projettent essentiellement des productions américaines (dont les titres ne sont même plus traduits), nos universités même - hérésie suprême - s'américanisent, ainsi l'université de la Sorbonne est devenue "Sorbonne université" (en attendant "Sorbonne university"?) tandis que le Prix Nobel d'économie Jean Tirole enseigne à la Toulouse School of Economics (ainsi qu'il a été présenté récemment sur France Culture). Dans d'autres domaines, l'apologie de l'immigration et du communautarisme, le puritanisme néovictorien ambiant ou encore la sacralisation du droit, tout dénote une américanisation et une protestantisation de plus en plus profonde des mentalités et des institutions. Je précise d'ailleurs que, pour moi, l'américanisation n'est pas contradictoire avec l'islamisation ou l'africanisation de la France. Dans l'esprit américain, le héros est le pionnier, le migrant, qui vient féconder en quelque sorte la terre prétendument vierge. Eh bien cette conception est en grande partie transposée par nos immigrationnistes patentés: les immigrés maghrébins et subsahariens viennent purifier la France de ses péchés historiques (racisme, colonialisme, esclavagisme, etc), et y apporter la vraie civilisation. C'est d'ailleurs amusant de constater que les mêmes qui pleurent sur le sort des Indiens d'Amérique rêvent d'éliminer - enfin de diluer par métissage - la population autochtone française.
A cette américanisation culturelle, il faut ajouter une forte influence allemande en matière de politique. Ce n'est pas un hasard si, récemment, Jean-Louis Borloo s'est prononcé en faveur d'une fédéralisation de la France. Le modèle allemand - ou suisse - hante une partie de nos élites. Ce modèle, c'est le triomphe du provincialisme qui s'accommode fort bien de la domination américaine, et pour cause, les Anglo-saxons comme les Allemands étant issus de la matrice germanique. Ce provincialisme s'exprime de la manière la plus aboutie dans l'Union Européenne (UE), dirigée par une Commission - les autres organes de fait ne servent à rien - à la tête de laquelle, ô hasard, se trouve une Allemande, Mme Von Der Leyen. Dans cette affaire de la construction européenne, les Français, un peu naïvement, se sont faits flouer: en bons jacobins, ils ont cru que l'UE, ce serait une France en grand, avec des ambitions, une volonté de puissance, une vision du monde originale. Eh bien non! L'UE, c'est une Allemagne en grand, pour ne pas dire une Suisse en grand, avec une vision étriquée du monde, une absence totale d'ambition, une mentalité de petit-bourgeois. Le rêve européen, ce n'est pas le rayonnement culturel et la participation au grand jeu diplomatique et géopolitique, non, c'est la BMW dans le garage et la piscine dans le jardin. La sortie de l'histoire dans le confort et la sécurité. Et qu'on ne vienne pas me dire que "si on avait plus d'Europe, les choses seraient différentes". L'UE est une construction de type germanique, conçue pour être inféodée à l'OTAN. D'ailleurs, les eurolâtres auraient dû voir que quelque chose clochait lorsque les pays de l'UE ont été incapables de bâtir une alliance militaire distincte de l'OTAN. L'Europe germanique, c'est la priorité aux petites affaires régionales, et le consensus mou à l'échelle continentale. Cela convient parfaitement à l'Allemagne qui met à genoux ses voisins, à commencer par son rival historique, la France, qui rêvait d'être un géant grâce à la construction européenne, et qui se retrouve à acclamer son voisin d'Outre-Rhin, le roi des nains, un peu comme les princes allemands acclamant dans la Galerie des Glaces de Versailles le roi de Prusse comme empereur, sans comprendre que c'en était fait de leur indépendance.
La France doit rompre avec cette Germanité mortifère, qu'elle soit anglo-américaine ou allemande. Aujourd'hui, l'Occident est tout entier imprégné par cette Germanité, il se limite à elle pour ainsi dire, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où la Germanité était équilibrée par la Latinité, à laquelle appartient la France, même si notre pays a subi une influence germanique non-négligeable dans les premiers siècles du Moyen Âge. C'est là, me semble-t-il, un point fondamental auquel devraient d'ailleurs réfléchir les identitaires: défendre son identité, c'est bien... à condition d'avoir une idée claire et précise de ce qui définit ladite identité. Je laisse de côté ceux qui se contentent de défendre "la race blanche" comme si la couleur de peau suffisait à définir une personne ou une communauté. Mais parmi les "nationalistes", il faut bien constater que bon nombre d'entre eux ressemblent davantage à des Texans, cigare et haine obsessionnelle de l'Etat à la bouche, corps bodybuildé entièrement tatoué, culte morbide des armes et de la violence porté en bandoulière. D'autres ne jurent que par le fatras pagano-runique des Vikings, peuple nordique (donc germanique), dont l'apport à la civilisation "occidentale" n'est pas exactement à la hauteur de la fascination qu'il suscite. Certains vont jusqu'à convoquer des symboles celtiques, alors que nous ignorons presque tout de la langue - et donc de la mentalité - des Gaulois. L'identité nationale française, comme toute identité nationale, est le résultat d'interférences culturelles, d'échanges, d'influences croisées. Certes, mais il ne faut pas exagérer: par la langue, par la culture, par la religion historiquement dominante, l'identité française se rattache indéniablement au monde latin, à la Latinité. Et c'est sur cette dernière que je voudrais me pencher, ainsi que sur son rôle historique majeur et ce que pourrait être son rôle dans l'avenir. Et je voudrais également montrer qu'il existe une autre Europe que celle qui siège à Bruxelles, mais aussi que l'Occident a un autre visage que celui, vulgaire et vénal, du Yankee.
Qu'est-ce que la Latinité?
J'entends ici par Latinité l'ensemble des groupes ethniques, des communautés, des peuples et des nations autochtones d'Europe parlant comme langue maternelle un dialecte roman, c'est-à-dire dérivé du latin. Alors certains me feront remarquer qu'il existe une Latinité américaine, et c'est vrai, mais celle-ci est une extension historique, coloniale pour être précis, de la Latinité européenne. Si l'influence européenne - ibérique pour être précis - est importante, les réalités sociales, culturelles, ethniques sont tout de même assez différentes. Cela étant, on peut s'interroger: tout le monde ou presque admet qu'il existe une "Amérique latine" en face de l'Amérique anglo-saxonne ; pourquoi ne pas admettre qu'il y a une Europe latine face à l'Europe germanique et à l'Europe slave? Pourquoi l'Europe devrait-elle former un tout homogène? Non, les peuples européens n'ont pas tous la même matrice identitaire. En Europe même, on peut distinguer une Latinité occidentale et une Latinité orientale. A la première appartiennent les peuples suivants: les Portugais, les Espagnols [1], les Français [1], les Italiens [1], les Wallons et les Bruxellois (en Belgique), les Romands et les Romanches (en Suisse). La Latinité orientale regroupe les Roumains [2], les Moldaves [2] et les petits groupes de Valaques (ou Aroumains) dispersés dans les pays des Balkans (Serbie, Macédoine, Grèce) lorsqu'ils conservent l'usage de leur langue, ce qui est de moins en moins le cas. La Latinité européenne ne coïncide pas avec le monde catholique: si la quasi-totalité des peuples de la Latinité occidentale sont historiquement de confession catholique (avec des minorités protestantes en France et en Suisse romande), la Latinité orientale est très majoritairement orthodoxe. De surcroît, nombre de pays catholiques (Autriche, Pologne, Croatie) n'appartiennent pas au monde latin. On notera cependant, et ce point a son importance, que la Latinité est restée globalement étrangère au protestantisme, ce qui plaide à mon avis pour une adéquation entre ce dernier et l'esprit germanique.
Voici une carte résumant la situation:
Carte conçue par l'auteur et réalisée en partenariat avec un collègue géographe
Ce qui définit la Latinité, c'est donc d'abord et avant tout la langue. Mais il faut bien comprendre ce qu'est une langue. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de communication. La langue, c'est plus que cela, la langue commande les structures de la pensée, et, in fine, la vision qu'on a du monde. C'est pourquoi l'invasion des anglicismes ne pose pas seulement un problème d'ordre esthétique, mais bien d'ordre intellectuel et culturel. A travers les mots, les tournures anglo-saxonnes, c'est la mentalité, le rapport au monde des Anglo-saxons - et tout particulièrement des Américains - qui s'immiscent dans nos mentalités. J'ai parlé, ailleurs, du Grand Remplacement ethnico-racial. Mais l'américanisation est une autre forme de Grand Remplacement, idéologique et intellectuel (qui d'ailleurs alimente et se nourrit de l'autre). On voit bien que la France, aujourd'hui, de plus en plus, est conçue comme une copie des Etats-Unis. Ainsi, pour parler du domaine que je connais, on voit en histoire une prolifération des thèses, des études, des ouvrages consacrés aux minorités raciales, aux groupes marginaux, à l'immigration, au "racisme systémique". Tous ces thèmes viennent des universités américaines. Beaucoup de ces études regorgent de mots anglais, qu'on ne se préoccupe plus de traduire. Au-delà du snobisme ambiant, il faut comprendre que ces productions sont en réalité de pâles copies de travaux réalisés Outre-Atlantique. Pourquoi de pâles copies? Parce que plaquer des concepts américains sur les réalités françaises n'a aucun sens: la France a une histoire, des institutions, un rapport à l'autre et au monde totalement différent de ceux des Américains. Et ce n'est pas injurier les Américains que de dire cela. D'ailleurs, bien des Américains intelligents le savent. Par exemple, en France, et dans le monde latin en général, on ne trouve pas cette obsession de la race qui est très présente dans le monde germanique. Cela ne veut pas dire que l'idée de race n'existe pas dans les cultures latines, loin de là, mais la question raciale ne revêt pas la même importance, et n'est pas abordée sous le même angle que chez les Anglo-saxons.
La Latinité porte une vision du monde, et cette vision du monde est héritée du monde romain et de la Méditerranée. Pour caricaturer un peu les choses, on peut dire qu'il y a deux espaces maritimes à l'origine de deux matrices identitaires européennes distinctes: la Méditerranée d'un côté, la mer du Nord de l'autre. Ce que je vais écrire là est un peu réducteur et un spécialiste ironiserait sans doute, mais je crois qu'on peut voir là des lignes de fracture qui sont assez parlantes. La Méditerranée est un espace de contact: depuis des siècles, la Latinité s'y confronte à l'altérité, celle des Grecs (avec lesquels elle a fini par créer une sorte de symbiose) et aussi celle des Sémites (Phéniciens, Carthaginois et Juifs dans l'Antiquité, Arabes à partir du Moyen Âge). Ces contacts ont façonné l'identité latine, ce qui ne signifie pas, je le précise, que la Latinité doit tout aux autres cultures, d'autant qu'elle a donné largement autant qu'elle a reçu, un point étrangement oublié à l'heure de faire le bilan de l'apport des uns et des autres. Aujourd'hui, on nous bassine avec l'islam, avec l'apport arabo-musulman, sans lequel nous autres Européens ne serions rien. Mais en réalité, les apports décisifs du monde sémitique à l'Europe sont bien antérieurs à la prédication de Mahomet. Et ils tiennent en deux mots: l'alphabet (d'origine phénicienne) et le christianisme (d'origine hébraïque). Par conséquent, depuis plus de deux millénaires, le Latin évolue au contact de l'Autre. Il lui achète des produits, lui emprunte des techniques, il le combat pour le contrôle du Bassin méditerranéen. Paradoxalement, la Méditerranée, cette mer fermée, a ouvert la Latinité sur le monde. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire du Latin que le Germain a eu accès aux sciences, aux techniques... et au christianisme.
La mer du Nord, mer ouverte, est au contraire à l'origine d'une vision du monde beaucoup plus fermée. Pourquoi? Parce que la mer du Nord est une mer purement germanique: tout le pourtour de cet espace maritime est occupé par des peuples de langue et de culture germanique, les Anglais, les Flamands et les Néerlandais, les Frisons, les Allemands, les Danois, les Norvégiens. Alors on me dira que les Ecossais sont des Celtes. C'est en partie vrai... mais ils ont été largement germanisés, même si ce fut à leur corps défendant, surtout dans les régions riveraines de la mer du Nord justement [3]. L'histoire de la mer du Nord a connu des rivalités, des conflits, des guerres, mais rien de comparable à ce qu'on observe en Méditerranée. Les peuples riverains avaient beaucoup en commun. Au début du XI° siècle, Knut le Grand règne sur l'Angleterre, le Danemark et la Norvège. On a parlé d'un "Empire de la mer du Nord", mais il s'agit davantage en réalité d'un Commonwealth de peuples germaniques. D'ailleurs il n'y a pas eu de tentative d'unification, même s'il est vrai que le temps a manqué. On le voit bien au niveau juridique: le monde germanique est un monde de droit local, coutumier, où le particularisme est la règle. Au contraire, le monde latin est un monde de droit écrit avec une tendance à l'unification. Le monde germanique apparaît en réalité refermé sur lui-même, sur ses communautés locales. On entend souvent que les Anglais sont un peuple de marins et les Français un peuple de paysans. C'est en partie vrai, et pourtant lorsqu'on y réfléchit, les Anglais ne sont pas plus "ouverts" que les Français. D'abord les Anglais sont des insulaires, et donc ils n'ont pas de réelles frontières terrestres, leurs voisins gallois et écossais faisant partie du Royaume-Uni depuis quelques siècles maintenant. Cela paraît un détail, mais je pense que cela a des conséquences importantes sur le rapport à l'autre. Mais prenons les Etats-Unis d'Amérique, un pays continental, avec une population nettement plus diversifiée, qui semble offrir un profil différent. Et pourtant, quand on regarde à échelle fine, la société américaine apparaît comme une juxtaposition de petites communautés locales, fondées sur l'appartenance ethnique ou religieuse. On peut aussi comparer les colonisations française et anglaise en Amérique du nord: là où les colons anglais puis les pionniers américains ont chassé ou éliminé les populations autochtones pour s'emparer de leurs terres et les exploiter, les Français (moins nombreux il est vrai) ont davantage cherché à intégrer les peuples indigènes à travers des accords et des traités d'alliance. Les Français ont vu dans les Amérindiens de possibles partenaires, là où les Anglo-saxons ont considéré ces derniers essentiellement comme des sauvages.
On voit donc que le monde germanique, historiquement, s'organise autour de la mer du Nord, de manière repliée sur lui-même [4]. Ses principaux contacts se font avec des populations apparentées: Celtes, Latins, Slaves. Le monde latin, via la Méditerranée on l'a dit, est en contact avec les mondes hellénique, slave, nord-africain et levantin. Le monde slave, quant à lui, situé au contact de l'immense steppe eurasiatique, entretient d'anciennes relations avec le monde turco-mongol et, via la mer Noire, les cultures iraniennes. Il n'y a finalement que la Germanité qui se trouve confinée dans le nord-ouest de l'Europe, sans véritable contact avec des aires culturelles très différentes. La Latinité ne forme pas un ensemble homogène, elle n'abolit nullement les spécificités régionales. La France du nord comme l'Italie septentrionale ont subi une influence germanique assez importante. L'Espagne a façonné son identité dans le cadre de la Reconquista menée contre les musulmans. Roumains, Moldaves et Valaques ont subi une forte influence gréco-slave. L'Italie n'a réalisé son unité que tardivement quand la France s'est constituée assez tôt comme Etat. Il faut aussi relever un certain nombre de tentatives pour bâtir des ensembles politiques qu'on pourrait qualifier de germano-latin: l'Empire carolingien en 800, le Saint Empire en 962 (qui comprend une composante essentiellement germanique, à savoir le royaume de Germanie, et deux composantes latines, le royaume d'Italie et le royaume d'Arles à partir de 1032), ou encore les états de Bourgogne au XV° siècle. On notera que ces ensembles politiques n'ont pas survécu: rapidement les empereurs germaniques ont été perçus comme des étrangers en Italie, par exemple; les ambitions en terres d'Empire de Charles le Téméraire (mort en 1477), duc de Bourgogne, étaient vues comme une menace "latine" par les princes allemands des régions rhénanes.
La Latinité à l'origine de la première mondialisation
Aujourd'hui, la mondialisation est devenue synonyme d'américanisation. La mondialisation, c'est Coca-Cola, Apple, Hollywood, McDonald's. C'est le consumérisme abêtissant, l'étalage de vulgarité, le culte décomplexé du fric et de la force. Attention, la culture américaine ne se résume pas à cela, loin de là, il y a de grands auteurs, de grands scientifiques, de grands cinéastes américains. Mais soyons honnête: les Etats-Unis exportent d'abord et avant tout les éléments standardisés d'une culture médiocre destinée à l'Américain moyen. Et, désolé de le dire, mais l'Américain moyen a tendance à être en-dessous de l'Européen moyen. Pourtant, la mondialisation - et les Anglo-saxons le savent parfaitement - a en réalité été impulsée par les Latins. Ce sont les états latins qui ont lancé les premiers grands voyages d'exploration, qui ont cherché à ouvrir de nouvelles routes commerciales. Et cela vient de loin. En Méditerranée, au début du Moyen Âge, la Latinité est en retrait: le Bassin méditerranéen est alors dominé par les Byzantins (qui ont une part de Latinité, mais l'élément grec est en train de devenir prépondérant) puis par les Arabo-musulmans. Lorsqu'on regarde l'empire carolingien, on constate que le centre du pouvoir se situe au nord de la Loire. Charlemagne et ses successeurs ont une politique méditerranéenne, en Italie, en Espagne, mais le fait est que l'empereur réside le plus souvent à Aix-la-Chapelle, non loin de la mer du Nord. On voit que, malgré tout, l'élément germanique est prépondérant dans le monde carolingien. Et cet héritage se fait encore sentir en France, pays né de l'éclatement de l'empire carolingien: Paris se situe dans ce coeur du pouvoir franc médiéval, et un coup d'oeil sur une carte suffit pour voir que la capitale de notre pays est plus proche de la mer du Nord que de la Méditerranée. C'est un élément visible et tangible de l'influence germanique sur la structure territoriale française: les Carolingiens comme les Capétiens sont issus du monde germanique, et ils regarderont longtemps vers l'est et vers le nord avant de s'intéresser au Midi.
Mais à partir du XI° siècle, les grandes cités portuaires italiennes, devenues largement autonomes par rapport au Saint Empire, vont remettre en cause l'hégémonie musulmane en Méditerranée. C'est un fait aujourd'hui peu connu mais, avant même les Croisades, Gênes et Pise mènent de rudes combats contre les pirates musulmans, leur arrachant la Corse et la Sardaigne. Venise et Amalfi, profitant de leur relation spéciale avec Byzance, connaissent aussi un développement important. Les Croisades vont faire la fortune de ces villes: transportant croisés et marchandises, Vénitiens, Génois et Pisans s'implantent en Terre Sainte, à Chypre, à Constantinople, avant de prendre le contrôle de la mer Egée. Les Vénitiens tiennent de nombreux points stratégiques en Grèce et ils sont les maîtres de l'Adriatique comme de la mer Ionienne. Les Génois, après avoir écrasé les Pisans, dominent la Méditerranée occidentale et en Orient, étendent leur contrôle sur la mer Noire et les grandes îles de l'Egée orientale (Lesbos, Chios). Dans la Dobroudja (région littorale aujourd'hui partagée entre la Roumanie et la Bulgarie), la Latinité occidentale se mêle à la Latinité orientale au XIV° siècle. La Méditerranée, aux XIII° et XIV° siècles, est en passe de devenir un lac italien. De cette époque date le voyage de Marco Polo jusqu'à la cour des grands khans mongols descendant de Gengis Khan. Mais le réveil de l'islam, avec l'ascension de l'Empire ottoman, met fin à la suprématie latine dans le bassin méditerranéen. Qu'à cela ne tienne: Marco Polo a fait connaître les immenses ressources de l'Asie. Sans doute existe-t-il un moyen d'y accéder par d'autres voies que les routes terrestres passant par le Levant désormais aux mains des Turcs. L'heure a sonné pour d'autres Latins de se lancer hardiment à la conquête des mers. Des ports italiens, le souffle de l'aventure se transporte dans la péninsule ibérique.
Le Portugal va jouer dans cette affaire un rôle central, qu'on oublie un peu aujourd'hui. Situé au finisterre occidental de l'Europe, le Portugal est le seul pays latin qui n'a aucun lien avec la Méditerranée (même les pays roumains du Moyen Âge, Valachie et Moldavie, avaient un débouché sur la mer Noire et donc un lien indirect avec le monde méditerranéen). Ayant terminé sa Reconquista plus tôt que son voisin castillan, le Portugal peut se lancer, dès le début du XV° siècle, dans l'exploration des côtes atlantiques de l'Afrique. La prise de Ceuta en 1415 marque en quelque sorte le coup d'envoi de l'ascension portugaise. Les ingénieurs et les marins du royaume perfectionnent navires et techniques de navigation. De nos jours, Christophe Colomb éclipse largement Vasco de Gama et Cabral, et c'est bien injuste. A l'aube du XVI° siècle, le Portugal devient une très grande puissance: en 1498, contournant l'Afrique, Vasco de Gama atteint l'Inde, ouvrant une route maritime vers l'Asie du sud et de l'est, ce qui, rappelons-le, était l'objectif essentiel de Christophe Colomb. En 1500, Cabral aborde ce qui deviendra le Brésil. Pendant une bonne partie du XVI° siècle, les Portugais ont le monopole du commerce avec l'Océan Indien. Ils établissent des comptoirs en Inde, puis conquièrent Malacca en 1511, ce qui leur ouvre l'accès à la mer de Chine méridionale et au Pacifique. En 1557, les Portugais s'établissent à Macao (ils y resteront jusqu'en 1999!) puis sont les premiers Européens à nouer des relations avec le Japon. Le Portugal est au sommet de sa gloire. Dès 1494, au traité de Tordesillas, Portugais et Espagnols se partagent le monde! Vers 1550, le royaume de Portugal, peuplé d'environ 1,5 million d'habitants seulement, contrôle un immense réseau de comptoirs, de ports, de forteresses, de l'Amérique du sud à l'Asie orientale en passant par l'Afrique. Sa flotte comptant des centaines de navires sillonne les océans et affronte les Ottomans dans l'Océan Indien. C'est alors l'un des pays les plus riches d'Europe et du monde. La réussite du Portugal tient à une chose: un Etat fort, centralisé, doté de très larges prérogatives économiques - eh oui, la mondialisation n'a pas toujours été libérale - à l'origine d'une organisation remarquable afin de suppléer la faiblesse démographique du pays. Rarement dans l'histoire un état de taille modeste aura détenu une telle puissance, fait preuve d'un tel dynamisme. L'ascension du Portugal, c'est aussi un miracle national, c'est la preuve qu'une nation, unie, cohérente, souveraine, peut, lorsqu'elle s'en donne les moyens, accomplir des choses sans commune mesure avec ce qui lui laisserait espérer sa taille. A méditer.
Mais le voisin espagnol n'est pas en reste. Si Christophe Colomb n'a pas trouvé la route pour l'Asie, son voyage de 1492 ouvre d'immenses perspectives au tout jeune royaume d'Espagne que les Rois catholiques viennent d'unifier par leur mariage et qui termine sa Reconquista par la prise de Grenade l'année même où la Pinta, la Nina et la Santa Maria cinglent vers l'Ouest. Les débuts de l'expansion espagnole sont assez différents, et davantage le fruit d'initiatives individuelles. Il faut dire que Charles Quint, roi d'Espagne de 1516 à 1556, est aussi héritier des ducs de Bourgogne et de l'empereur habsbourg. La lutte contre la France, l'Empire ottoman et bientôt les princes allemands gagnés au protestantisme absorbe une bonne partie du temps et de l'énergie du monarque. C'est sans l'aval du gouverneur espagnol de Cuba qu'Hernan Cortés et une poignée d'hommes débarquent en Amérique centrale en 1519. En deux ans, la grande puissance de la région, l'Empire aztèque, est détruite et les Espagnols sont maîtres du pays. Dix ans plus tard, en 1532, Francisco Pizarro, avec une audace comparable, s'empare par traîtrise de l'empereur inca, Atahualpa, et s'assure le contrôle du Pérou et d'une bonne partie de la Cordillère des Andes. La réussite éclatante, presque surréaliste, de ces conquistadores suscite de nos jours, et à juste titre, une forme de perplexité, entre admiration et répulsion. Brutaux, cupides, sans scrupules, volontiers cyniques et cruels à l'occasion, Cortés et Pizarro l'ont été, assurément. Mais Cortés - je connais moins Pizarro - a montré dans toute son entreprise une intelligence, une finesse, un sens politique, une compréhension des rapports de force absolument remarquables. Rappelons quand même que ces hommes pénètrent dans des régions inconnues, rencontrent des peuples aux moeurs et aux mentalités très différentes des leurs. Ils sont à la tête de bandes aux effectifs réduits, loin de leurs bases et, en ce qui concerne Cortés, son entreprise n'a pas le soutien formel des autorités espagnoles. On peut bien sûr s'indigner des massacres commis, et s'horrifier de la destruction de Tenochtitlan, la Venise du Mexique. Mais ce qu'ont réussi Cortés et Pizarro relève de l'exploit, et suppose une forme de génie politique. Il faut aussi admettre, même si ça n'excuse pas tout, que les Aztèques ou les Incas, en terme de cruauté et de brutalité, n'avaient pas forcément de leçon à recevoir. Le monde précolombien n'a jamais été un Paradis, un jardin d'Eden paisible et harmonieux que seraient venus troublés les Castillans barbus et bardés de fer.
On ne refera pas l'histoire de toute façon. Et le fait est qu'à la fin du XVIII° siècle, les Portugais et les Espagnols contrôlent les plus vastes empires coloniaux. Leurs langues sont parlées sur tous les continents. La troisième nation latine atlantique, la France, s'est lancée plus tard dans l'aventure, mais les résultats sont loin d'être négligeables. Envoyé par François 1er, Jacques Cartier commence l'exploration de la région du Saint-Laurent dans les années 1530. Les troubles liés aux guerres de religion tiennent la France éloignée des projets d'expansion outre-mer jusqu'à l'aube du XVII° siècle. Mais ensuite, la politique coloniale reprend avec une certaine vigueur: Canada, Louisiane, Antilles (Saint-Domingue surtout), Guyane, mais aussi île Bourbon (la Réunion aujourd'hui) et île de France (Maurice) dans l'Océan Indien, et bientôt l'Inde, sans oublier Gorée et Saint-Louis au Sénégal, les rois de France déploient une intense activité maritime et coloniale pour tenter de rattraper le retard pris sur les voisins ibériques. Et là encore, l'action de l'Etat est décisive: Colbert, avec l'appui de Louis XIV, crée Lorient et les grandes Compagnies de commerce. Vers 1750, ce premier empire colonial français est loin d'être méprisable. Mais la Guerre de Sept ans (1756-1763), la première "guerre mondiale", a raison de cette expansion. Louis XV est vaincu et doit abandonner l'Amérique du nord, et, sans doute beaucoup plus grave, laisser la domination de l'Inde aux Britanniques (rappelons qu'au XIX° siècle, la base de la puissance impériale britannique hors d'Europe est l'Empire des Indes, qui comprend toute l'Asie du sud). Il sauve cependant ce qui est considéré comme les joyaux de la Couronne, si j'ose dire, à savoir les îles à sucre des Caraïbes, la Guyane et les comptoirs d'Afrique. Toujours est-il que vers 1800, les états de la Latinité occidentale sont encore maîtres de vastes et riches territoires.
Le XIX° siècle marque un recul très important et un déclin considérable des grandes nations latines. Le Portugal n'est plus que l'ombre de lui-même, même s'il conserve ses colonies africaines (Guinée-Bissau, Angola, Mozambique) et ses comptoirs asiatiques. Le riche Brésil, principale source de revenus pour la Couronne portugaise au XVIII° siècle grâce aux mines d'or et de diamants, se sépare pacifiquement de la métropole pour devenir un Empire indépendant et suivre sa propre voie. L'Espagne connaît une situation encore plus dramatique: toutes ses colonies d'Amérique acquièrent leur indépendance, pour tomber sous l'influence économique et parfois politique des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne. L'Espagne s'enfonce dans les crises et les guerres civiles. La guerre hispano-américaine de 1898 fait perdre ce qui restait des lambeaux d'un empire sur lequel "le soleil ne se couchait jamais", à savoir Cuba et les Philippines. Désormais, les Etats-Unis exercent leur hégémonie dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Avec le Royaume-Uni, à la tête d'un empire colonial qui regroupe un quart de l'humanité en 1900, l'affaire est entendue: la mondialisation prend une nette coloration anglo-saxonne, qu'elle ne perdra plus. Face à ce qu'il faut bien appeler la mise en place de l'hégémonie germanique - car, en Europe, au même moment, l'Empire allemand est devenu la puissance dominante après 1870 - une seule nation latine tente de résister: la France. A la fin du XIX° siècle, notre pays constitue son deuxième empire colonial, à partir de l'Algérie, du Sénégal et de l'Indochine, territoires en partie contrôlés au moins depuis le Second Empire. L'Italie, enfin unifiée, essaie de se faire une place en Méditerranée (Libye, Dodécanèse) et en Afrique de l'est (Somalie, Erythrée), mais sa défaite face à l'Ethiopie à Adoua en 1896 fait du pays la risée de l'Europe. De plus, les ambitions coloniales créent des tensions entre les deux nations-soeurs que sont la France et l'Italie, au sujet de la Tunisie notamment.
Au-delà des alliances de circonstances, on constate tout de même une volonté constante des puissances anglo-saxonnes d'affaiblir la France, et plus encore de la part des Etats-Unis que du Royaume-Uni. Pour ce dernier, pays européen, une France assez forte restait une assurance contre une Allemagne devenue dangereuse à la fin du XIX° siècle. Pour les Américains en revanche, la sécurité nationale ne dépendait pas de la France. Pendant la Première Guerre Mondiale, les Anglais sont venus se battre sur le sol français. C'est notre territoire qui a souffert des combats. Les Américains, eux, n'ont daigné se déplacer qu'à la fin de la guerre, à un moment où la France était épuisée par une lutte horriblement meurtrière. Si ce n'est pas voler au secours de la victoire... Lors des négociations qui ont abouti au Traité de Versailles, les Britanniques n'ont eu de cesse d'empêcher un affaiblissement significatif de l'Allemagne. Les Américains ont contesté le retour de l'Alsace-Moselle à la France. On accuse encore de nos jours l'intransigeance française d'avoir humilié l'Allemagne, préparant ainsi l'arrivée au pouvoir des nazis et le second conflit mondial. On oublie un peu vite que la France voulait démanteler la puissance allemande précisément pour éviter une nouvelle guerre. Après 1933, les dirigeants britanniques ont refusé de voir le danger hitlérien, et les dirigeants français n'ont pas osé agir quand le III° Reich a remilitarisé la Rhénanie. On connaît la suite. Et on doit en tirer une leçon: lorsque la France se met à la remorque des Anglo-saxons, elle en tire rarement profit. En 1944, les Américains auraient bien voulu écarter de Gaulle et mettre en place un gouvernement à leur dévotion dans une France vassalisée. C'est pour moi la plus grande victoire de de Gaulle que d'avoir réussi à restaurer notre souveraineté au moment de la Libération. Par la suite, les Etats-Unis se sont montrés favorables au mouvement de décolonisation, sans compter qu'ils ont profité de la menace communiste pour imposer leur hégémonie militaire en Europe de l'ouest. La France est le seul pays - avec de Gaulle à nouveau - qui a refusé cette vassalisation totale, qui s'est efforcé de conserver une force militaire autonome et une diplomatie indépendante. Ce précieux héritage, on le voit bien, est en passe d'être perdu: au Kosovo comme en Ukraine, la France s'aligne sagement sur les intérêts américains aux dépens des siens.
L'Espagne, affaiblie par un siècle de guerres civiles entre le milieu du XIX° et le milieu du XX° siècle, a retrouvé une certaine prospérité à la fin du XX° siècle, mais elle est empêtrée dans la lutte sans fin contre les séparatismes basque et catalan. Son horizon géopolitique ne dépasse guère l'échelle régionale de la Méditerranée occidentale. C'est un allié fidèle des Etats-Unis. Le Portugal, pays vieillissant et en crise, ne s'est jamais vraiment remis de la perte de son Empire. Ce paradis pour retraités n'affiche plus guère d'ambition géopolitique. L'Italie, très atlantiste, ne regarde pas au-delà de la Méditerranée. La gestion des flux migratoires et une démographie inquiétante constituent ses préoccupations principales. La France - du moins ses élites - s'est résolue à rentrer dans le rang. A l'est, les problématiques sont autres. La Roumanie, après des décennies de régime communiste, a rejoint avec enthousiasme le bloc occidental atlantiste. Une partie de la population roumaine, cependant, rechigne à rejoindre la Croisade contre la Russie... mais les élections sont annulées quand un candidat critique de la politique occidentale est en passe de les gagner. La Moldavie est un pays pauvre, déstabilisé politiquement et affaibli économiquement par la sécession de fait de la Transnistrie russophone, un pays en proie de surcroît à d'interminables querelles identitaires (les Moldaves sont-ils un rameau de la nation roumaine ou bien une nation à part? La langue parlée est-elle le roumain ou un dialecte distinct?). En ce début de XXI° siècle, la Latinité fait pâle figure, et n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut. Les Américains et les Allemands peuvent se frotter les mains: tous les pays latins sont en retrait, laissant l'Europe sous la domination économique de l'Allemagne et le monde sous l'hégémonie politique et culturelle anglo-saxonne.
La Ligue gréco-latine, un possible outil d'émancipation
Comment enrayer le déclin de la Latinité, de nos nations? Ceux qui connaissent un peu mes convictions ne s'en étonneront guère: je ne propose évidemment pas de créer une "Union européenne-bis" centrée sur les nations latines. Non, je propose la création d'une Ligue gréco-latine, un peu sur le modèle de la Ligue arabe. Car, après tout, qu'est-ce qui constitue le trait d'union entre les pays arabes? C'est la langue et la culture arabes, plus que l'islam, puisque tous les musulmans ne sont pas des Arabes, loin s'en faut. Mais au sein de la Ligue arabe, chaque état membre reste souverain, possède sa monnaie, contrôle ses frontières. Pour moi, la souveraineté des nations n'est pas un principe parmi d'autres: c'est la pierre angulaire de la conception politique du monde que je souhaite promouvoir. Par conséquent, la Ligue gréco-latine telle que je la conçois serait un organisme scrupuleusement respectueux de la souveraineté de ses membres. D'ailleurs, je rejette tout organe de type "parlement latin" ou "cour de justice de la Ligue". L'expérience de l'UE ne nous a que trop montré où nous menaient les dérives des institutions supranationales. Point de constitution non plus. Les instances de la Ligue seraient purement inter-gouvernementales, avec des sommets réguliers. Je propose la rédaction d'une Charte fixant de manière générale les grands objectifs de cette Ligue: développer et renforcer la coopération économique, culturelle, diplomatique et même militaire entre les membres, dans le strict respect de la souveraineté de chacun (et il me paraît important que cela soit noté noir sur blanc). Bien sûr, cela n'exclut pas que chaque état membre noue par ailleurs des alliances et des coopérations avec des pays hors de la Latinité. C'est un fait que les intérêts des nations latines ne convergent pas toujours, et chacun doit rester libre. On peut fort bien imaginer que certains états membres restent dans l'OTAN, même si, à titre personnel, je suis favorable à une sortie de la France de cette structure. Et, pourquoi pas, on pourrait même imaginer le maintien d'une Union européenne... vidée de sa substance et privée de la plupart de ses actuelles prérogatives.
Pourquoi une Ligue "gréco-latine" et non pas seulement "latine"? Ainsi que je l'ai expliqué plus haut, la Latinité et l'Hellénisme ont vécu en symbiose pendant plusieurs siècles, de la conquête romaine du monde grec jusqu'à la partition définitive de l'Empire romain en 395. L'Empire que nous nommons "byzantin" au Moyen Âge était de langue et de culture grecques, mais il s'est toujours réclamé de l'héritage romain, d'un point de vue institutionnel et juridique. "Basileus et autocrator des Romains" fut le titre des empereurs byzantins jusqu'à la mort de Constantin XI en 1453. Venise et Gênes ont été présentes en mer Egée, et des Français, des Italiens et des Catalans ont dominé le Péloponnèse et la Grèce centrale pendant près de deux siècles. Plus qu'avec les Germains et les Slaves, c'est avec les Grecs que nous autres Latins avons le plus d'affinité. C'est pourquoi je propose d'intégrer la Grèce et Chypre à la Ligue, baptisée pour cette raison "Ligue gréco-latine". Reste le cas de la Belgique: faut-il considérer que la Wallonie donne de fait la légitimité pour entrer dans la Ligue? Je serai tenté de répondre par l'affirmative, mais on peut supposer que les Flamands s'y opposeraient. Si la Wallonie devenait un état indépendant - ce qui n'est pas forcément souhaitable - elle serait bien sûr la bienvenue. En revanche, la Suisse, malgré ses minorités francophone, italophone et romanche, est un pays à dominante germanique et je ne pense pas que sa place soit au sein de la Latinité. Au final, on pourrait avoir cette configuration:
Carte conçue par l'auteur et réalisée en partenariat avec un collègue géographe
Ainsi que je le disais, les grandes nations latines n'ont pas systématiquement les mêmes intérêts géopolitiques. Je pense néanmoins qu'il y a matière à travailler et à coopérer ensemble sur un certain nombre de dossiers. La régulation des flux migratoires en Méditerranée en est un, tous nos pays y ont intérêt. Le développement d'une diplomatie de "bon voisinage" dans les Balkans, comme avec la Russie ou le monde arabo-musulman, également. Combattre la tentation néo-ottomane de la Turquie d'Erdogan (qui par ailleurs fait du chantage à l'immigration) peut aussi être un objectif commun. Cela étant dit, il n'est pas certain que tous les pays de Ligue voudront conclure une alliance militaire. En ce qui concerne la coopération économique, cela peut aller d'accords de libre-échange à une entente sur les normes imposées aux produits. Vous me direz que l'UE le fait déjà... mais elle le fait à notre place, et pas forcément dans notre intérêt. Là, chaque état négocierait les accords bilatéraux qui lui conviennent, car il n'y a pas de raison d'imposer les mêmes termes à tout le monde. Enfin, dernier point, le développement de la coopération culturelle, l'entraide pour la préservation du patrimoine, la défense de nos langues romanes, tout cela revêt pour moi une importance capitale. En France, l'enseignement de l'espagnol se porte bien, mais je suis favorable à ce qu'un effort soit fourni pour l'enseignement d'autres langues romanes, le portugais, le roumain et surtout l'italien qui, je trouve, est trop peu enseigné dans notre pays. Il faudrait je crois repenser toute la structure de l'enseignement des langues vivantes, pour mettre fin à la domination écrasante de l'anglais comme LV1 et de l'espagnol comme LV2. Il est difficile de se passer de l'anglais, c'est un fait, mais celui-ci devrait davantage être proposé en LV2, et non seulement en LV1. Par ailleurs, je serais assez favorable à ce qu'une option facultative "initiation à une LV3" soit proposée en collège à partir de la 4ème (puisque la LV2 est désormais enseignée dès la 5ème). On pourrait aussi, par exemple, envisager dans certains cas de coupler l'enseignement du latin avec une initiation à une langue romane, autre que le français ou l'espagnol. Mais bon, il y a tout le système éducatif français, ses moyens comme ses objectifs, à revoir. On pourrait aussi imaginer la création de "Jeux de la Latinité" avec des concours sportifs et culturels (je rappelle qu'il existe des Jeux de la Francophonie et des Jeux du Commonwealth).
Tout cela, bien sûr, ce ne sont que des pistes. Il est toujours périlleux de tirer des plans sur la comète. Mais je crois qu'il y a là matière à réfléchir à une reconfiguration géopolitique de l'Europe. On voit bien en Grèce comme en Italie une forme de germanophobie poindre. La lassitude vis-à-vis de l'UE et de l'incurie de ses dirigeants est général. Pourquoi ne pas songer à bâtir un espace de coopération, respectueux des souverainetés nationales, avec des pays qui ont une réelle proximité culturelle entre eux?
[1] Alors bien sûr, on peut soulever la question des Basques, des Bretons, des Alsaciens, des Flamingants (de Flandre française) ou encore des germanophones d'Italie du nord, tous locuteurs d'une langue non romane. Je sais que les régionalistes hurleront à l'oppression des minorités, mais je le dis: il y a dans chaque pays une langue "nationale". Et n'en déplaise aux sécessionnistes de tout poil, cette langue nationale est le castillan en Espagne, le français en France et l'italien en Italie. La Belgique et la Suisse sont des cas à part, puisque ces pays ont en fait une structure fédérale et communautariste de type germanique, où le multilinguisme est revendiqué comme tel. Pour la Belgique, on pourrait même se demander si on n'a pas affaire à un état binational.
[2] Les Magyars de Roumanie ou les russophones de Transnistrie appellent les mêmes remarques que pour les groupes parlant une langue non-romane dans les pays d'Europe occidentale, et évoqués dans la note précédente.
[3] Je signale à ce sujet que parmi les langues parlées en Ecosse, on trouve le "scots", une langue germanique qui s'est répandu dans le pays dès le Moyen Âge et qui dérive de dialectes du nord de l'Angleterre (le northumbrien). Il regrouperait aujourd'hui environ un million et demi de locuteurs en Ecosse et en Irlande du nord. C'est beaucoup plus que le nombre de locuteurs du gaélique écossais, qui est une langue celtique. Comme pour la Bretagne en France, l'identité "celtique" de l'Ecosse est discutable, et en tout cas variable selon les régions: forte dans les Highlands, beaucoup moins dans les Lowlands qui regroupent les grandes villes et la majorité de la population écossaise.
[4] On pourrait discuter du cas viking. Au-delà de la prédation et du commerce engendrés par les expéditions des aventureux scandinaves, quel a été l'impact réel de l'épopée viking? A-t-elle modifié la langue, la mentalité, la structure sociale des hommes du nord? En fait, le seul élément majeur survenu à la fin de la période viking est la conversion progressive des Scandinaves au christianisme, sachant que les autres groupes germaniques (Anglais, Francs, Saxons, Frisons) avaient déjà adopté la foi chrétienne. Ce changement ne doit pas être sous-estimé, et sans doute a-t-il favorisé l'émergence de grands royaumes centralisés en lieu et place des chefferies locales plus ou moins autonomes. Mais le vieux fond culturel nordique ne paraît pas non plus avoir été bouleversé. Les seuls Scandinaves qui ont véritablement subi des influences extérieures sont ceux qui, installés hors de Scandinavie, se sont latinisés (les Normands, en France puis en Sicile) ou slavisés (les Varègues de Kiev)...